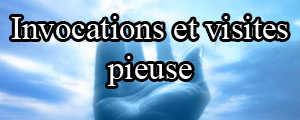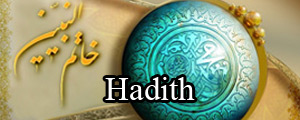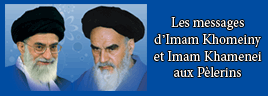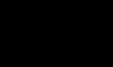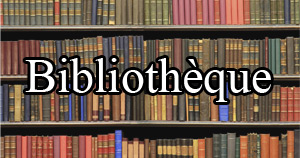Malgré la bonne volonté de certains participants, la conférence de Paris pour la Libye n’a pas eu sur place les effets imaginés. Pour Thierry Meyssan, cela s’explique par le double langage de l’Otan et de l’Onu qui prétendent vouloir stabiliser le pays alors que leurs actions poursuivent le plan Cebrowski de destruction des structures étatiques. La mise en scène de Paris était imprégnée d’une profonde méconnaissance des particularités de la société libyenne.
تقي زاده
Rohani en Chine : Pékin et Téhéran pour un partenariat économique à part
En visite en Chine pour participer au 18e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président iranien s'entretiendra, également, avec son homologue chinois.
Le déplacement en Chine de Hassan Rohani pour participer au sommet de Shanghai sera l'occasion pour le chef du pouvoir exécutif iranien d'explorer des opportunités d'affaires avec la Chine dans le domaine économique, après le retrait des États-Unis de Trump de l’accord nucléaire et l’annulation des dizaines de milliards de dollars de contrats signés entre l’Iran et les avionneurs Airbus et Boeing, les constructeurs d’automobile français, et le géant pétrolier Total.
Ainsi, le retrait des entreprises européennes notamment françaises du marché iranien rouvre le terrain à la Chine. Les groupes chinois remplaceront aussitôt leurs rivaux européens.
Le marché iranien de 78 millions d'habitants favoriserait également les coopérations boursières Téhéran-Pékin. À cette fin, la signature d’un accord entre Rohani et la partie chinoise qui sait saisir l’occasion est prévue.
Le président Xining a réservé un accueil chaleureux à Hassan Rohani qui prendra part à Pékin au diner offert par son homologue chinois en son honneur.
Les deux pays poursuivront également leurs coopérations économiques dans le cadre de l’initiative de « la Ceinture et la Route » proposée par le président chinois Xi Jinping en 2013, et qui consiste en la Nouvelle ceinture économique de la Route de la Soie, reliant la Chine à l'Europe via l'Asie centrale et occidentale, et la Route de la Soie maritime du XXIe siècle, reliant la Chine aux pays d'Asie du sud-est, à l'Afrique et à l'Europe.
Washington va adopter les sanctions « les plus dures de l'Histoire », comme l’a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo, deux semaines après le retrait controversé et unilatéral de Trump de l'accord international sur le nucléaire iranien.

S’agissant du renforcement du partenariat économique sino-iranien, la porte- parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, a déclaré que Pékin élargira ses coopérations avec Téhéran.
S’exprimant le samedi 9 juin, au micro du journaliste de l’agence de presse officielle iranienne, Irna, la diplomate chinoise a déclaré que malgré le retrait des États-Unis du Plan global d'action conjoint, Pékin poursuivra ses coopérations économiques avec l’Iran et cela sans violer ses engagements internationaux.
S’agissant d’un éventuel retrait des sociétés européennes de l’Iran après le retrait américain et les sanctions imposées par Washington à Téhéran, la diplomate a dit que son pays s’oppose aux pressions et aux sanctions unilatérales contre les pays, dont l’Iran.
Trump désengage les USA de l'accord nucléaire avec l'Iran et Macron ?
La résistance a été de courte durée : alors que le monde suit attentivement "la riposte" européenne aux sanctions américaines contre l'Europe ( les taxations, ainsi que le souligne le président russe, constituent en fait des sanctions, NDLR), les premiers signes de capitulation "européenne" se manifestent : en Allemagne, la chancelière affirme avoir accepté de dépenser 1.5% du PIB comme "droit de participation" à l'OTAN tandis que le président français promet de faire face aux côtés des États-Unis à l'Iran.
Le président américain, Donald Trump et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont rencontrés en marge du G7, la réunion annuelle de sept principales économies libérales de la planète (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Russie, Royaume-Uni, Italie, Canada) qui a débuté, ce vendredi 8 juin, au Canada. Une réunion qui se tient sur fond d'extrêmes tensions entre les deux bords de l'Atlantique à la suite des taxes décidées par les États-Unis sur l'acier et l’aluminium.
La partie française s'est payé le luxe, une fois encore, à évoquer avec la partie américaine " les activités régionales de l'Iran", si on en croit un communiqué publié par la Maison Blanche à l’issue de la rencontre. La Corée du Nord s'est aussi invitée dans les débats. Le départ du constructeur automobile PSA, celui probable de Total ou encore d'autres déboires infligés par le retrait us de l'accord nucléaire de 2015 aux entreprises françaises actives en Iran, étant totalement absents des débats, Macron et Trump ont discuté des moyens "d’accroître leur coopération pour contrecarrer" ce que Trump qualifie de « rôle déstabilisateur » de l’Iran dans la région, bien que ce rôle ait largement bénéficié à la France dans la mesure où sans l'appui iranien dans la guerre contre le terrorisme en Irak et en Syrie, Daech aurait quotidiennement commis des attentats sur le sol français.
La Libye selon l’Onu et la dure réalité
- Conférence de presse finale du sommet de Paris, le 29 mai. De gauche à droite : Fayez Al-Sarraj (président du Gouvernement libyen d’union nationale, désigné par l’Onu), Emmanuel Macron (président de la République française), Ghassan Salamé (fonctionnaire de l’Onu). Ces trois hommes, qui n’ont aucune légitimité élective en Libye, espèrent décider de l’avenir du Peuple libyen.
Depuis l’anéantissement par l’Otan de la Jamahiriya arabe libyenne, en 2011, la situation en Libye s’est profondément détériorée : le PIB a été divisé par deux et des pans entiers de la population vivent dans la misère ; il est impossible de circuler dans le pays ; l’insécurité est générale. Au cours des dernières années, les deux tiers de la population se sont enfuis à l’étranger, au moins provisoirement.
Passant par pertes et profits l’illégalité de l’intervention de l’Otan, les Nations Unies tentent de re-stabiliser le pays.
Les tentatives de pacification
L’Onu est présente via la MANUL (Mission d’appui des Nations unies en Libye), qui est un organe exclusivement politique. Le véritable caractère de cette instance est apparu dès sa création. Son premier directeur, Ian Martin (ancien directeur d’Amnesty International), organisa le transfert de 1 500 jihadistes d’Al-Qaïda en qualité de « réfugiés » (sic) de la Libye vers la Turquie pour former la soi-disant « Armée syrienne libre ». Certes, aujourd’hui la MANUL est dirigée par Ghassan Salamé [1], mais elle dépend directement du directeur des Affaires politiques de l’Onu qui n’est autre que Jeffrey Feltman. Or, cet ancien assistant d’Hillary Clinton au département d’État US est un des maîtres d’œuvre du plan Cebrowski-Barnett pour la destruction des États et des sociétés du « Moyen-Orient élargi » [2]. C’est précisément lui qui supervisa d’un point de vue diplomatique les agressions contre la Libye et la Syrie [3].
L’Onu part de l’idée que le désordre actuel est la conséquence de la « guerre civile » de 2011 qui dressa le régime de Mouammar Kadhafi contre son opposition. Or, lors de l’intervention de l’Otan, cette opposition se limitait aux jihadistes d’al-Qaïda et à la tribu des Misrata. En tant qu’ancien membre du dernier gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne, je peux témoigner que l’initiative de l’Alliance atlantique ne répondait pas à un conflit libyen, mais à une stratégie régionale de longue haleine pour l’ensemble du Moyen-Orient élargi.
Lors des élections législatives de 2014, les islamistes qui avaient mené les combats au sol pour le compte de l’Otan, n’obtinrent que de faibles résultats. Ils décidèrent alors de ne pas reconnaitre la « Chambre des représentants » (basée à Tobrouk) et de constituer leur propre assemblée (basée à Tripoli) qu’ils appellent désormais « Haut Conseil d’État ». Considérant que ces deux assemblées rivales pouvaient former un système bicaméral, Feltman plaça à égalité les deux groupes. Des contacts entre eux eurent lieu aux Pays-Bas, puis les accords de Skhirat (Maroc) furent signés, mais sans l’assentiment des deux assemblées. Ces « accords » instituèrent un « gouvernement d’union nationale » (d’abord basé en Tunisie) désigné par l’Onu.
Pour préparer l’élaboration d’une nouvelle Constitution et d’élections présidentielle et législatives, la France, se substituant aux efforts des Pays-Bas et de l’Égypte, a organisé fin mai un sommet avec ceux que l’Onu présente comme les quatre principaux leaders du pays, en présence de représentants des principaux États impliqués sur le terrain. Cette initiative a été vivement critiquée en Italie [4]. Publiquement on a parlé politique, tandis que discrètement, on a dessiné les contours d’une Banque centrale libyenne unique qui effacera le vol des Fonds souverains libyens par l’Otan [5] et centralisera l’argent du pétrole. Quoi qu’il en soit, après la signature d’une déclaration commune [6] et les embrassades d’usage, la situation a brusquement empiré sur le terrain.
Le président français, Emmanuel Macron, agit en fonction de son expérience de banquier d’affaires : il a réunit les principaux leaders libyens choisis par l’Onu ; a examiné avec eux comment protéger leurs intérêts respectifs en vue de créer un gouvernement reconnu par tous ; a vérifié que les puissances étrangères ne saboteraient pas ce processus ; et a pensé que les Libyens applaudiraient cette solution. Or, il n’en est rien car la Libye est totalement différente des sociétés occidentales.
Il est évident que la France, qui avait été avec le Royaume-Uni le fer de lance de l’Otan contre la Libye, tente de récupérer les dividendes de son intervention militaire, dont elle a été privée par ses alliés anglo-saxons.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir en arrière et analyser la manière dont vivent les Libyens en fonction de leur expérience personnelle.
L’Histoire de la Libye
La Libye n’existe que depuis 67 ans. À la chute du fascisme et la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette colonie italienne fut occupée par les Britanniques (dans la Tripolitaine et la Cyrénaïque) et par les Français (dans le Fezzan qu’ils divisèrent et rattachèrent administrativement à leurs colonies d’Algérie et de Tunisie).
Londres favorisa l’émergence d’une monarchie contrôlée depuis l’Arabie saoudite, la dynastie des Senussis, qui régna sur le pays à partir de « l’indépendance », en 1951. De religion wahhabite, elle maintint le nouvel État dans un obscurantisme total, tout en favorisant les intérêts économiques et militaires anglo-saxons.
Elle fut renversée, en 1969, par un groupe d’officiers qui proclama la véritable indépendance et mit à la porte les Forces étrangères. Au plan politique intérieur, Mouammar Kadhafi rédigea, en 1975, un programme, le Livre vert, dans lequel il garantit à la population du désert de satisfaire ses principaux rêves. Par exemple, alors que chaque bédouin ambitionnait d’avoir sa propre tente et son chameau, il promit à chaque famille un appartement gratuit et une voiture. La Jamahiriya arabe libyenne offrit également l’eau [7], l’éducation et la santé gratuites [8]. Progressivement, la population nomade du désert se sédentarisa sur la côte, mais les liens de chaque famille avec sa tribu d’origine restèrent plus importants que les relations de voisinage. Des institutions nationales furent mises en place, inspirées des expériences des phalanstères des socialistes utopiques du XIXème siècle. Elles instaurèrent une démocratie directe tout en co-existant avec les anciennes structures tribales. Ainsi, les décisions importantes étaient d’abord présentées à l’Assemblée consultative des tribus avant d’être délibérées par le Congrès général du Peuple (Assemblée nationale). Au plan international, Kadhafi se voua à résoudre le conflit séculaire entre les Africains, arabes et noirs. Il mit fin à l’esclavage et utilisa une grande partie de l’argent du pétrole pour aider au développement des pays sub-sahariens, notamment du Mali. Son activité réveilla les Occidentaux qui commencèrent alors des politiques d’aide au développement du continent.
Cependant, malgré les progrès accomplis, trente ans de Jamahiriya ne suffirent pas à transformer cette Arabie saoudite africaine en une société laïque moderne.

- Ghassan Salamé et son patron, Jeffrey Feltman
Le problème actuel
En écrasant ce régime et en faisant flotter à nouveau le drapeau des Sénussis, l’Otan a renvoyé le pays à ce qu’il était avant 1969 : un ensemble de tribus, vivant dans le désert, coupées du monde. En l’absence d’État, la population s’est repliée sur des structures tribales sans chef suprême. La Charia, le racisme et l’esclavage ont refait leur apparition. Dans ces conditions, il est inefficace de chercher à rétablir l’ordre par le haut. Il est au contraire indispensable de pacifier d’abord les relations entre tribus. Ce n’est qu’une fois cette opération achevée qu’il sera possible d’envisager des institutions démocratiques. Jusque-là la sécurité de chacun ne sera garantie que par son appartenance tribale. Pour survivre, les Libyens s’interdiront donc de penser de manière autonome et s’en référeront toujours à la position de leur groupe.
Le cas de la répression exercée par les habitants de Misrata contre ceux de Tawarga est exemplaire. Les Misratas sont les descendants des soldats turcs de l’armée ottomane, ceux de Tawarga descendent d’anciens esclaves noirs. En lien avec la Turquie, les Misratas ont participé au renversement de la Jamahiriya. Dès que le drapeau des Sénussis a été imposé, ils se sont déchainés avec une fureur raciste contre les noirs. Ils les ont accusés de toutes sortes de crimes et ont contraint 30 000 d’entre eux à fuir.
Il sera évidemment très difficile de faire émerger une personnalité, comparable à Mouammar Kadhafi, qui soit d’abord reconnue par les tribus, puis par le Peuple. Mais en réalité, ce n’est pas ce que cherche Jeffrey Feltman. Contrairement aux déclarations officielles sur une solution « inclusive », c’est-à-dire intégrant toutes les composantes de la société libyenne, Feltman a imposé, via les islamistes avec qui il avait collaboré au département d’État contre Kadhafi, une loi interdisant toute fonction publique aux personnes ayant servi le Guide. La Chambre des représentants a refusé d’appliquer ce texte, toujours en vigueur à Tripoli. Ce dispositif est comparable à celui de la débaasification que le même Feltman imposa à l’Iraq, lorsqu’il était un des dirigeants de l’« Autorité provisoire de la Coalition ». Dans les deux cas, ces lois privent ces pays de la majorité de leurs élites et poussent celles-ci à la violence ou à l’exil. On le voit bien, Feltman poursuit toujours les objectifs du plan Cebrowski tout en prétendant travailler pour la paix.
Contrairement aux apparences, le problème de la Libye n’est pas la rivalité entre des leaders, mais l’absence de pacification entre tribus et l’exclusion des Kadhafistes. La solution ne peut être négociée entre les quatre leaders réunis à Paris, mais uniquement au sein et autour de la Chambre des représentants de Tobrouk dont l’autorité couvre désormais 80 % du territoire.
[1] Ghassan Salamé est un homme politique libanais et universitaire français. Il est le père de la journaliste française Léa Salamé et de la directrice de la Fondation Boghossian de Belgique, Louma Salamé. Il a travaillé avec Jeffrey Feltman en Irak, mais pas au Liban.
[2] « Le projet militaire des États-Unis pour le monde », par Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haïti) , Réseau Voltaire, 22 août 2017.
[3] « L’Allemagne et l’Onu contre la Syrie », par Thierry Meyssan, Al-Watan (Syrie) , Réseau Voltaire, 28 janvier 2016.
[4] En 2011, le président du Conseil Silvio Berlusconi s’insurgea contre l’intervention de l’Otan. Il fut rappelé à l’ordre atlantiste par son propre Parlement.
[5] « La rapine du siècle : l’assaut des volontaires sur les fonds souverains libyens », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto(Italie) , Réseau Voltaire, 22 avril 2011.
[6] « Déclaration politique sur la Libye », Réseau Voltaire, 29 mai 2018.
[7] À partir de 1991, la Libye construit la « Grande rivière artificielle ». Il s’agit d’un vaste réseau d’exploitation des nappes aquifères du Bassin de Nubie, situées à grande profondeur. Ce gigantesque système est sans équivalent dans le monde.
[8] En l’absence d’hôpitaux assez nombreux, les opérations étaient souvent effectuées à l’étranger aux frais de l’État.
Le Hezbollah révèle l’implication des Émirats dans les achats immobiliers à Qods occupée
Le Hezbollah révèle l’implication des Émirats dans la vente de maisons appartenant aux habitants de Qods
Le secrétaire général du Hezbollah libanais a révélé les tentatives de certains États arabes du golfe Persique destinées à acquérir des maisons, appartenant aux habitants de Qods.
Seyyed Hassan Nasrallah a déclaré, le vendredi 8 juin, que certains États arabes du golfe Persique entendaient acheter des maisons d’habitants de Qods en échange de sommes élevées dans le cadre d’un nouveau complot à l’encontre de la ville de Qods visant à servir les intérêts d’Israël.
Israël évite l'humiliation et ne se présente pas au Conseil de sécurité
Israël, de peur d'être humilié, a renoncé à présenter sa candidature de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2019-2020.
L'Allemagne, la Belgique, la République dominicaine, l’Afrique du Sud et l’Indonésie ont été élus, le 8 juin, par l'assemblée générale de l'ONU en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour les années 2019 et 2020.
Israël a renoncé à présenter sa candidature de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2019-2020. La nouvelle n’a pas secoué le monde diplomatique. Le régime occupant et criminel d'Israël, conscient de sa chance minime dans la course a choisi d'éviter l'humiliation et ne pas se présenter.
Sur les 190 pays présents lors de l’élection, l’Allemagne a recueilli 184 voix, la Belgique 181, l’Afrique du Sud 183, l’Indonésie 144 et la République dominicaine 184 et cela sans rivalité, car il fallait obtenir deux tiers des voix présentes pour être élu.
Un diplomate a confié à l’AFP que le régime de Tel-Aviv a, une fois de plus, fini par renoncer au siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU « en raison de ses chances très minimes de gagner.» Selon lui, Israël aurait tout au plus obtenu 50 voix et c'est pourquoi, ne voulant pas perdre la face, il a opté pour le renoncement.
Dôme de fer est une "plaisanterie"
Selon le général Firouzabadi, l’inefficacité du système de défense antimissile israélien, Dôme de fer, a été portée au grand jour au fur et à mesure des agressions armées d'Israël contre Gaza.
Les plans de Washington sont tombés à l’eau
Selon le chef du parti turc Vatan Partisi, la récente politique étrangère de la Maison-Blanche s’est soldée par l’isolement de Washington sur le plan international.
« Le plan américain pour un grand Kurdistan comme ses autres plans de ces dernières années est tombé à l’eau », a déclaré Dogu Perinçek, le leader du parti, lors d’une interview avec Sputnik.
« Washington veut toujours dicter sa loi au reste du monde. Or, on peut dire que sa politique au Moyen-Orient face à l’Iran, la Turquie, la Russie et la Syrie aussi bien que celle face à l’Europe et à la Chine a dysfonctionné », a affirmé Perinçek.
« L’union de l’Iran, de la Russie, de la Turquie et de la Syrie, formée pour contrer les positions de la Maison-Blanche, a fait tomber à l’eau le sinistre plan de Washington pour créer un grand Kurdistan », a-t-il souligné.
« La résistance de l’Allemagne et de la Chine face aux tensions commerciales avec les USA a contribué à l’échec de la politique étrangère de Washington et l’a isolé au niveau international », a-t-il conclu.
Le régime sioniste n'est pas une puissance
Le général de Brigade Ahmad-Reza Pourdastan. (Archives)
« Pour assurer le retour du peuple innocent de la Palestine à sa terre ancestrale, le monde musulman est déterminé à lui venir en aide et à éliminer littéralement le régime d’Israël », a affirmé le général.
« Les faits témoignent du commencement du compte à rebours de l’anéantissement d’Israël dans un délai même plus court que celui de 25 ans prévu par le Leader de la République islamique », a-t-il ajouté.
« Suite à la Révolution islamique en Iran, le soutien à Israël a été ébranlé et a été transmis aux États arabes du golfe Persique, qui devaient dorénavant servir de ceinture de protection aux sionistes », a-t-il poursuit.
« La décision de l’Imam Khomeiny de décréter le dernier vendredi du mois de ramadan comme “Journée mondiale de Qods” a redonné du sens à l’aspiration du peuple palestinien, qui avait été affaiblie voire oubliée par les compromis, et en a fait une préoccupation majeure du monde musulman », a expliqué Pourdastan, directeur du Centre d’études stratégiques de l’armée iranienne.
« L’échec d’Israël dans la région a marqué la fin de ses ambitions. Craignant l’influence et la force des centaines de jeunes Palestiniens, Tel-Aviv n’a d’autre choix que de s’entourer d’une clôture de barbelés et d’ériger de longs murs autour des territoires qu’il occupe », a conclu le général Pourdastan.
Israël craint le déclenchement d’affrontements avec le Hamas
Citant des sources auprès de l’armée israélienne, le journal rapporte qu’un grand nombre de forces militaires seront déployées le long des frontières de la bande de Gaza : « Les estimations de Tel-Aviv laissent prévoir l’organisation d’une manifestation de masse susceptible de dégénérer en violence. Les Palestiniens tentent toujours de traverser la ligne de séparation. C’est pourquoi Israël prévoit des tués et des blessés. »
Selon le quotidien israélien, « Tel-Aviv n’a émis aucun nouvel ordre pour changer d’attitude vis-à-vis des Palestiniens qui lancent des cerfs-volants incendiaires car il craint que cela n’aboutisse à des affrontements avec le Hamas ».
« Il n’est pas dans l’intérêt stratégique d’Israël d’entrer en conflit avec le Hamas. Israël ne peut pas agir autrement avec ceux qui lancent des cerfs-volants incendiaires », ajoute le quotidien.
Dans la foulée, un site d’information israélien a révélé que le système sécuritaire israélien craignait les tirs de missiles en direction des territoires occupés dans la journée.
Près de 120 Palestiniens ont été tués et 10 000 autres blessés par les militaires israéliens depuis le début d’une série de manifestations marquant la Marche du grand retour.
La Jordanie croule sous les pressions de Washington et de Tel-Aviv
« Nous avons entamé le dialogue et prendrons dans les plus courts délais des mesures qui remettront le pays sur les rails », a déclaré le nouveau Premier ministre lors de sa première interview télévisée.
Avant que les manifestations n’entrent dans leur quatrième jour, Abdallah II, le roi jordanien, a demandé à Hani al-Moulki de démissionner et l’a remplacé par Omar al-Razzaz, ex-ministre de l’Éducation, qui doit former un nouveau gouvernement.
Le journal israélien Yediot Aharonot a révélé dans son édition d’il y a deux jours que Riyad, Tel-Aviv, Le Caire et Washington sont en grande partie à l’origine du soulèvement populaire en Jordanie.
Ces jours-ci, Amman est confronté à deux problèmes : sa mise à l’écart de l’accord conclu entre Washington, Tel-Aviv, Riyad et Le Caire sur le transfert de l’ambassade américaine à Qods, et la vague de manifestations en cours dans les grandes villes contre le projet de loi fiscale et l’augmentation du prix du carburant et de l’électricité, a expliqué le journal.
Selon l’analyse du quotidien israélien, il y a bien un lien fort entre ces deux affaires qu’en apparence tout sépare. Derrière un fard de richesse et de fortune, la Jordanie n’arrive pas à joindre les deux bouts sans l’aide financière de ses alliés.
Le roi Hussein et son fils Abdallah II avaient pu bénéficier du soutien financier des alliés du golfe Persique de Washington et, de plus, d’une somme fixe du Fonds monétaire international (FMI). Mais d’un seul coup tout a changé. Pour s’aligner sur la Maison-Blanche, Riyad a mis fin à son soutien à Amman. L’Égypte, dont les caisses de l’État sont vides, et les EAU n’ont pas tardé à suivre le mouvement, a conclu le journal.
D’ailleurs, une vidéo publiée le mercredi 6 juin montre une partie de la réunion du roi jordanien lors de laquelle il déclare : « On nous dit : rejoignez notre camp pour l’affaire de Qods en contrepartie d’une d’atténuation des pressions économiques auxquelles la Jordanie est confrontée. »
Selon certains observateurs, Abdallah II ferait allusion au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane.