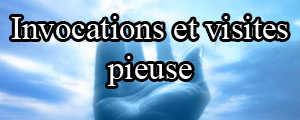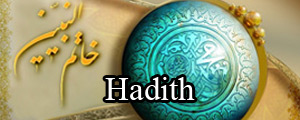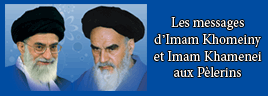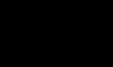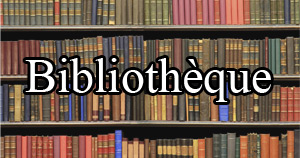تقي زاده
L'Iran s'engage à poursuivre son assistance consultative en Syrie
Les groupes terroristes, qui se disent islamiques, mais dont les actions sont non islamiques, commettent des crimes odieux non seulement contre les non-musulmans, mais aussi contre les musulmans de la région. L'Irak et la Syrie font partie des pays ravagés par le terrorisme, a-t-il ajouté.
L'Iran, proche allié de la Syrie et de l'Irak, a joué un rôle majeur dans la guerre contre le terrorisme dans les deux pays.
La France est le "soutien au terrorisme"
"La France a été le porte-étendard du soutien au terrorisme en Syrie dès les premiers jours" du conflit, a estimé M. Assad, en référence au soutien apporté par Paris aux groupes armés qui luttent contre le système depuis 2011 et que Damas qualifie de "terroristes".
"Elle n'est pas en position de donner une évaluation d'une conférence de paix", a-t-il déclaré à des journalistes, après avoir reçu à Damas une délégation de responsables et d'hommes d'affaires russes. "Celui qui soutient le terrorisme n'a pas le droit de parler de paix et n'a même pas le droit de s'ingérer dans les affaires syriennes", a-t-il précisé.
Qods: veto des États-Unis à l’ONU
Les États-Unis ont mis leur veto ce lundi 18 décembre à la résolution onusienne qui condamne la reconaissance de Qods comme capitale d'Israël, annonce l'agence de presse ISNA.
« Nous opposerons notre veto à cette résolution », avait préalablement déclaré Nikki Haley. Elle a critiqué la résolution 2334 du Conseil de sécurité voté en 2016 malgré l’abstention des États-Unis qui juge illégale la colonisation des territoires palestiniens par le régime d’Israël.
Sur les quinze membres du Conseil de sécurité, quatorze ont donc voté pour cette résolution dont les alliés européens des Américains.
Présenté par l'Égypte, le texte réclamait que la décision de Donald Trump soit révoquée. La reconnaissance de Qods a déclenché la colère des Palestiniens, des manifestations dans le monde musulman et une réprobation quasi unanime de la communauté internationale.
Grève des employés de Teva à Qods
La grève des employés de Teva se poursuit à Qods pour la deuxième journée consécutive. Ils s’étaient barricadés à l’intérieur de l’usine de Har Hotzvim pour protester contre les licenciements planifiés du groupe. Et dimanche, ils ont bloqué la circulation après avoir quitté les deux usines de la compagnie.
La société pharmaceutique israélienne Teva, confrontée à de sérieuses difficultés financières, a annoncé jeudi dernier le plan de restructuration de l’entreprise qui prévoit la suppression de 14.000 emplois dans le monde au cours des deux prochaines années, soit 25% de ses effectifs. Teva fait travailler en tout plus de 55 000 personnes.
Dimanche 17 décembre au matin, les manifestants se sont retrouvés devant les bureaux de la compagnie à Qods, dans les villes côtières de Netanya et d’Ashdod, dans la ville de Petah Tikva, dans le centre d’Israël, à l’occasion de divers rassemblements qui ont coïncidé avec une grève de solidarité entamée ce lundi et qui a touché les aéroports, les banques et les bureaux gouvernementaux israéliens. Ce mouvement de solidarité a touché presque toutes les parties du secteur public toute la journée.

À Qods, les manifestants ont bloqué la circulation après avoir quitté les deux usines de la compagnie – qui sont menacées de clôture – dans la zone industrielle de Har Hotzvim en direction du bureau du Premier ministre. La police a annoncé que les participants ont fait brûler des pneus; des incendies qui ont été rapidement éteints.
Ce sont ainsi plusieurs centaines d’employés qui se sont rassemblés devant les bureaux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ils ont ensuite défilé en scandant notamment « c’est la guerre, la guerre, la guerre » pour exprimer leur colère, bloquant un moment la principale route d’accès de Qods avant de rejoindre leur usine qu’ils ont occupée, selon un journaliste de l’AFP.
La décision de Trump sur Qods continue de mobiliser les différentes capitales européennes
Selon Farsnews, depuis une dizaine de jours, de grandes villes européennes sont le théâtre d'importantes manifestations dénonçant la décision du président américain de reconnaître la sainte ville de Qods comme la capitale d'Israël et d'en faire le siège de l'ambassade américaine.
Majid Al-Zeïr, le chef du congrès des Palestiniens d'Europe qui est également à la tête du centre al-Awda (le retour), a déclaré que le soutien des Européens avait contribué à renforcer l'unité palestinienne et la coordination entre les institutions palestiniennes, arabes et musulmanes.
Al-Zeïr a ajouté que les manifestations en Europe avaient en outre renvoyé un message clair à Donald Trump: celui qu'il avait franchi la ligne rouge.



Libye: le maire de Misrata enlevé et tué
L'hôpital de la ville a confirmé avoir reçu le corps du maire, qui portait des impacts de balles.
Son frère, qui se trouvait dans le même véhicule au départ de l'aéroport, a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger, selon la même source de sécurité.
M. Eshtewi rentrait d'un voyage officiel en Turquie, en compagnie d'autres membres du Conseil municipal, tous élus en 2014 et dont le mandat doit expirer fin 2018.
Sur son compte Twitter, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a exprimé "sa profonde tristesse et sa ferme dénonciation" de ce meurtre.
Misrata, cité portuaire d'environ 400.000 habitants, est considérée comme l'une des villes les plus sures de Libye.
Elle compte les groupes armés les plus puissants du pays et avait joué les premiers rôles dans la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, ainsi que dans la libération en 2016 de Syrte, alors aux mains du groupe Daech.
En octobre, un attentat suicide revendiqué par Daech avait fait quatre morts dans un complexe judiciaire de Misrata.
La France sélectionne les réfugiés africains
"J'ai passé quatre ans dans un camp, on était mille là-bas", explique Djamel, 42 ans, arrivé avec sa femme et ses quatre enfants.
Cet ancien épicier, qui prenait l'avion pour la première fois, se dit "fatigué" mais "content", même s'il n'a "aucune idée de l'endroit où il va" - il devine juste, à la doudoune qu'on lui a fournie au départ, qu'"il fait froid".
Les nouveaux arrivants, qui ont reçu le document attestant de leur statut de réfugiés des mains de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), sont ensuite montés dans des cars en direction de Thal-Noirmoutier (Bas-Rhin) où ils seront logés dans un vaste couvent en grande partie inoccupé, où vivent encore quelques religieuses.
L'islam et l'environnement
Dans les récits coraniques sur le paradis d’avant ressortent des enseignements importants à méditer. En effet, Dieu dit avoir fait des recommandations (ahd) à Adam, ce qui établit la notion d’Alliance entre Lui et l’être humain en ce qu’Il ne l’abandonne pas à sa solitude et ses limites : « En effet, Nous avons auparavant fait une recommandation à Adam ; mais il oublia ; et Nous n’avons pas trouvé chez lui de résolution ferme ». Ces recommandations sont la boussole ou la guidance qui rattache l’humain à Dieu. En d’autres termes, un gage de succès sur terre et de salut dans l’au-delà est déjà de s’ouvrir à la transcendance et de ne pas faire l’option de la suffisance. Ce souci de Dieu pour l’humain apparaît aussi dans le don des paroles de demande de pardon, l’acceptation du repentir, et la promesse de guidance tenue à Adam et à son épouse après leur glissade au paradis : « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir car c’est Lui certes, le Repentant, le Miséricordieux. Nous dîmes : «Descendez d’ici, vous tous ! Toutes les fois que Je vous enverrai une guidance, ceux qui suivront Ma guidance n’auront rien à craindre et ne seront point affligés». (Coran, 2 : 37-38) ; « Puis, si jamais une guidance vous vient de Ma part, quiconque suit Ma guidance ne s’égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l’amènerons aveugle au rassemblement». Il dira : «Ô mon Seigneur, pourquoi m’as-Tu amené aveugle alors qu’auparavant je voyais?» [Allah lui] dira : «De même que Nos Signes t’étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd’hui tu es oublié». (Coran, 123-126)
Au fait, Adam a oublié quoi et a manqué de résolution par rapport à quoi ? Voici des questions auxquelles des réponses sont données dans le Coran, notamment les récits du paradis d’avant. Examinons de plus près ce qu’il se passe au paradis perdu et qui, à la lumière du Coran, constitue un éclairage capital sur les sources véritables de la ruine de l’être humain. Iblîs banni de la miséricorde de Dieu après s’être révolté par orgueil et refuser de se prosterner devant Adam, donc de reconnaître que celui-ci est le nouveau dépositaire du Califat, est lui aussi au paradis d’avant. Dans ce paradis, Adam reçoit des recommandations de Dieu, une sorte de code de conduite qui inclue de ne jamais oublier qu’Iblîs est son ennemi implacable qui a pour seul but de provoquer sa ruine : « Alors Nous dîmes : “Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu’il ne vous fasse sortir du Paradis, car alors tu seras malheureux” ».
Comment Satan procède-t-il pour égarer le premier couple humain à la lumière de ce que nous enseignent les récits coraniques susmentionnés ? Les mots-clés des stratagèmes de Satan sont : prétention, séduction, fausse promesse, imposture, illusion et sournoiserie. En effet, Iblîs qui prétend connaître ce qu’il manque au premier couple humain trouble la vie tranquille de celui-ci en suscitant chez lui un désir de quelque chose qu’il n’avait pas imaginé de son propre chef. En face, les mots-clés de la glissade du premier couple sont : naïveté, oubli et désir. Selon certains exégètes, ce n’est pas à la première tentative d’Iblîs que le couple va céder. Ce dernier répète ses assauts avec un contenu renouvelé mais toujours trompeur, s’y ajoute qu’il se dit de bonne foi et jure pour se faire croire.
Un enseignement capital de ces récits est que, par son murmure mielleux et trompeur, Iblîs suscite chez le premier couple humain le désir de démesure. Iblîs fait miroiter seulement à Adam, une chose qui relève du pouvoir et aux deux (Adam et son épouse), deux choses qui relèvent du rapport au temps et de leur nature en tant que telle. C’est dire qu’il fait croire à Adam qu’il est moins que ce qu’il pourrait être et ce faisant, suscite chez lui une envie de puissance et d’autre part, il incite nos deux grands parents à vouloir échapper au temps et à leur humaine nature. Il n’est pas exagéré de penser que ces récits coraniques du paradis perdu, suite à la glissade du premier couple humain, préfigurent une sorte de complexe de démesure qui a beaucoup à voir avec la crise environnementale.
Un autre enseignement de ces récits coraniques est que le marchand d’illusion n’a pas d’emprise directe sur Adam et son épouse. Il n’annihile pas le libre arbitre de ces deux premiers êtres humains. Il a juste la possibilité de susciter chez l’individu le désir qui finit par gouverner son « Nafs » (âme charnelle) et le mobiliser vers la recherche vaine de ce qu’il ne peut ni être ni posséder. L’enjeu n’est pas de savoir de quel arbre il s’agit et quelles parties en ont consommées mais ce qu’il représente, à savoir, la limite et la frontière à ne pas franchir au risque de s’égarer en mentant à notre nature d’humain et en nous assignant de fausses finalités. Et si une fin est hors de portée, à quoi servent alors tous les moyens du monde conçus et mobilisés aux fins de l’atteindre ?
Il se trouve que c’est cet enjeu qui traverse le destin en entier de l’homme, qui cristallise tous les dangers auxquels il s’exposera et tous les drames dont il sera l’agent lors de son séjour sur terre. Avant la transgression de l’interdit dont l’objet est redéfini et embellit par celui que le Coran appelle le trompeur (al gharûr), c’est le bonheur illusoire promis à Adam et son épouse. Mais, à l’horizon, après avoir passionnément voulu posséder et dominer tout, et être autre et plus, c’est la désillusion qui est récoltée par le premier couple humain. Selon le récit du Coran, la descente aux enfers peut-être infléchie et l’homme peut se donner une nouvelle espérance à travers l’humilité qui pousse à la reconnaissance de la faute non pas contre Dieu mais contre soi-même, contre sa propre nature humaine et le repentir qui est un engagement de changer de comportement pour le meilleur. Ces récits coraniques nous enseignent que la condition d’un vrai bonheur à hauteur d’homme réside dans la liberté de se donner des limites, de pouvoir renoncer au superflu et à toute forme d’excès et d’opter pour la frugalité et la mesure.
Il est bon de s’arrêter un instant sur la sanction de la transgression au paradis perdu pour la comparer avec ce qu’il se passera sur terre. Selon les récits coraniques, en mangeant quelque chose de l’arbre interdit d’accès, le couple ne fait tort qu’à lui-même. Il y a là toute une pédagogie de l’interdit ou du renoncement librement consenti qui devient source de liberté et de quiétude et non d’asservissement ou de limitation du potentiel humain. De quelle liberté parle-t-on s’il est dit que rien ne peut plus être arrêté ou changé parce-que le « système » enjoint de continuer, même jusqu’à être son propre fossoyeur ? A coup sûr, il y a dans ces récits du paradis perdu, un enseignement capital à méditer longuement et profondément sur la dialectique entre liberté et responsabilité. Si l’homme veut tout maitriser sauf lui-même, il se fera tort inexorablement. S’il veut assumer pleinement sa liberté tout en oubliant les limites à lui fixer, il va à la ruine.
Défense de l’environnement et citoyenneté : leçons amères d’un engagement inabouti
En plus de ce souci environnemental, motivé par la compréhension des enseignements islamiques déclinés plus haut, je me suis posé la question de sa traduction concrète. En effet, je ne voulais pas en rester à déclamer des versets et hadiths alors que par exemple et par proximité, je ne voyais aucune action significative menée par la société civile pour infléchir le désastre du littoral de Dakar. J’ai alors opté pour rejoindre un groupe dont les propos des meneurs me semblaient convaincants et désintéressés. Ce groupe se déclarait préoccupé par la défense de tout le littoral sénégalais, tout en commençant par la corniche de Dakar. Je m’étais engagé dans cette lutte de défense du littoral vu son importance écologique et récréative, me justifiant de ce que l’intendance de la terre est confiée à l’humanité et que si les décideurs publics ne mesurent pas l’enjeu d’un problème environnemental, il fallait le leur rappeler de façon responsable au moyen des prérogatives que la loi donne au citoyen.
Ce groupe rassemblait des individus à titre personnel et des associations de riverains du littoral. Le président d’honneur de la plateforme dite citoyenne était une personne influente du secteur de la profession libérale au Sénégal et ses accointances avec différents régimes politiques étaient controversées. La mobilisation a porté ses fruits, puisque quelques membres du groupe ont été reçus par le Président de la République en personne. Après avoir écouté les doléances du groupe, le Président, avec à ses côtés des ministres et des élus locaux de Dakar, s’est dit lui-même environnementaliste (il a une formation d’ingénieur en sciences de la terre) et sensible à l’état du littoral, rappelant qu’il avait pris des engagements dans ce sens pendant sa campagne électorale. Cependant, le Président n’a pas manqué de mentionner que certaines autorisations administratives, telles que le permis d’occuper, ont été données par les élus de la ville de Dakar et d’autres par le régime précédent le sien.
Pour finir, le Président a demandé à son ministre de l’économie et des finances de piloter un groupe de concertation composé de membres du gouvernement, des services de l’État, ainsi que des représentants des organisations du groupe qui menait la lutte pour la défense du littoral. Le Président demanda qu’un rapport sur les aspects juridiques, fonciers et environnementaux soit déposé sur sa table dans un délai de deux semaines. Enfin, le président nous proposa une visite guidée pour constater l’état de la corniche avec nous.
Ce qui fut fait, la presse ne rata pas l’occasion et l’opinion fut sensibilisée encore plus sur la question et le projet de construction d’une ambassade fut arrêté sur décision du présidentielle. Motivés par l’attention que le Président a accordée au groupe de lutte pour la défense du littoral, les membres firent preuve de plus d’engagement et se virent rejoints par d’autres qui avaient pris conscience du problème mais avaient déchanté par découragement. La presse organisa nombre de débats autour de la question. Des réunions plus ou moins régulières se tinrent entre le groupe citoyen et le gouvernement, des visites de terrain concertées eurent lieu. Le groupe citoyen apporta au gouvernement et à ses services les informations en sa possession sur l’occupation du littoral. Le rapport demandé par le Président prit du retard, car nombre de questions étaient beaucoup plus complexes que prévu.
À mon niveau, nombre de frustrations ont commencé à naître, au fur et à mesure que le groupe se réunissait et que certaines pratiques me rendaient perplexe et soupçonneux. Voici quelques-unes des raisons qui, in fine, me poussèrent à prendre la décision de quitter le groupe : le désordre que je constatais dans les réunions inutilement longues où on débattait sans ordre du jour ou qui n’était pas respecté s’il en existait ; elles se tenaient dans les bureaux du président d’honneur, soupçonné par certains de velléités d’instrumentalisation du groupe ; les entretiens informels entre ce dernier et certains ministres, parlant au nom du groupe avec des bailleurs et des diplomates, sans concertation préalable ; des projets à financer concoctés par certains membres du groupe de lutte pour la défense du littoral ; la faible ou la non implication des élus locaux, auxquels sont dévolus certaines compétences de gestion environnementale à travers la décentralisation.
J’ai été particulièrement choqué de voir le président d’honneur d’un groupe citoyen de lutte pour la défense du littoral prendre des engagements devant le gouvernement, faire des promesses et rencontrer des bailleurs pour le financement de son propre projet dans des espaces libérés grâce à la pression populaire, le tout de façon unilatérale et sans concertation préalable avec le groupe. Mes questions et mes critiques sur ces façons de faire envenimaient de plus en plus les réunions, car je refusais les réponses autoritaires du concerné et qui ne semblaient pas gêner la majorité du groupe. J’ai aussi eu droit à des remarques du genre : « laissons-le faire, il s’y connaît et nous avons confiance et il constitue notre porte d’entrée au palais présidentiel ». Je me suis aussi rendu compte que certains membres du groupe avaient des projets déjà prêts et qu’ils voulaient expulser certains occupants du littoral pour pouvoir les mettre en œuvre.
Cette façon de faire m’a paru insupportable, parce que pour moi il devait s’agir d’un aménagement concerté et inclusif du littoral sous la supervision de l’Etat, incluant l’équité entre toutes les parties prenantes. Hélas, je faisais face à une association de la société civile qui surfe sur l’environnement avec des pratiques peu éthiques et qui joue sur des préoccupations populaires pour être un lobby qui fait chanter les pouvoirs publics aux fins d’obtenir des privilèges. Les pouvoirs publics savent aussi comment s’y prendre avec ce genre de groupes pour les empêcher de jouer leur vrai rôle de sentinelle et de lanceurs d’alerte influant au niveau de l’opinion publique, sans pour autant apporter des réponses aux vraies questions environnementales.
J’ai fini par considérer que je n’étais plus dans un espace citoyen et j’ai balancé ceci au groupe comme une sorte de motif de démission : « Pour moi, un groupe citoyen doit travailler selon au moins deux critères qui font défaut au nôtre : la transparence et la concertation ». On m’a ensuite soufflé qu’après mon départ, mes critiques ont permis de changer la mentalité et les pratiques du groupe ! J’ai répondu tant mieux alors sans avoir aucun moyen de vérification de ces rumeurs et en doutant de la sincérité de ce genre d’argument.
Conclusion
J’ai beaucoup appris de cette expérience où, par le truchement de la défense de l’environnement, j’ai essayé de traduire ma foi islamique sur une question d’intérêt commun à tous les citoyens, croyants ou non. Il se trouve que j’ai été ô combien déçu de voir que ce sont la cupidité et la convoitise qui sont subrepticement à l’œuvre par le truchement de la manipulation des masses à travers une cause juste. D’une part, cette expérience m’a permis de constater que les hommes et femmes politiques (sans vouloir généraliser) sont gangrénés par la corruption, les intérêts partisans, les accointances louches avec des privés et le manque de courage pour prendre et appliquer des décisions nécessaires. Et voici qu’une partie de la société civile qui devait jouer un rôle de veille et d’alerte environnementale se laisse emporter par le même état d’esprit et se complaisent dans les mêmes pratiques qu’elle condamnent pour se faire une bonne image devant l’opinion publique et mieux la tromper.
Dans cette soi-disant société civile qui fait l’option de la marchandisation de l’environnement, se cachent des gens qui ont les mêmes pratiques que les politiques corrompus et les maîtres-chanteurs. Au milieu de tout cela, c’est le citoyen naïf qui est pris en otage et c’est la nature qui devient de plus en plus un bien privé, au détriment de la grande masse. Dans cette expérience, je n’ai pas perdu ma foi, vu que je me suis souvenu comme j’ai pu des récits coraniques sur le paradis perdu, mais mon espérance environnementaliste en a reçu un sacré coup.
Quel est l’avis des religieux sunnites sur le recours aux Saints Imams ou à des personnes ?
Mamousta Molla Rashid Thana’i, imam de la prière du vendredi de Sar-pol-e-zohab, a déclaré que les religieux sunnites autorisaient le recours aux Saints Imams à condition qu’ils ne soient pas considérés comme des égaux de Dieu
Mamousta Hossein Eyni, imam de la prière du vendredi de Paveh, a déclaré que lors de l’absence de pluies, les musulmans avaient recouru à l’oncle du prophète (as), Hazrate Abbas. Ce recours est permis lorsque la personne concernée n’est pas mise au rang de Dieu mais ce serait du polythéisme dans le cas contraire.
Mamousta Mohammad Mohammadi Yari, directeur de l’école Molawi Yari, a déclaré que le recours était permis à une personne ou à de bonnes actions effectuées dans le passé, et qu’il existait dans le Coran et les hadiths prophétiques, de nombreuses allusions à cette pratique
Mamousta Mollah Adel Gholami, imam de la mosquée Al-Nabi (as) de Ghasr-e-shirin, a déclaré que le mot « Tawasol » signifiait « moyen » mais
que dans le Coran, ce terme signifiait un acte qui rapproche de Dieu, et que pour les sunnites, ce terme signifie de recours à Dieu dans la prière, le jeûne, le Hadj et le Khoms, ajoutant que demander quelque chose à Dieu, en recourant au haut statut du prophète (as), des Imams (as) ou des compagnons, était aussi permis.
Le Conseil des fatwas et des religieux de Sanandaj a déclaré que le recours était permis dans le cadre des prières pour les autres, d’actes de bienfaisance et de recours aux noms divins
Le cheikh Ebrahim Mohammadi, Imam de la prière du vendredi d’Assalouyeh, a déclaré que le recours était permis chez les sunnites mais seulement dans le cadre des noms et des attributs divins, et des bonnes actions accomplies dans le passé, et a ajouté qu’il était permis de demander à une personne vivante de prier pour nous.
Le cheikh Mohammad Jamali, imam de la prière de Kangan, a déclaré que les sunnites accepter le recours aux prières des sages et des croyants vivants, et le recours aux actes de bienfaisance.
Le cheikh Abdoul Sattar Harami, imam de la prière des sunnites de Nakhl Taghi, a déclaré que le recours aux prières des bienfaisants et des « Amis
de Dieu » était permis ainsi que le recours à de bonnes actions et aux noms divins.
Le cheikh Khalil Efra’, membre du Conseil de programmation des centres islamiques sunnites, vice-président du Conseil des religieux sunnites et président du Conseil des fatwas, a déclaré que le mot « Tawasol » signifiait « le recours à un moyen » et que Raghib Isfahani avait expliqué que le mot « وسيله » était une chose ou une personne à laquelle nous recourrions volontairement et par sympathie.
Cependant dans le sens religieux de recours pour le pardon des péchés ou la réalisation d’un vœu, au prophète (as), aux gens pieux en vie ou aux compagnons en vie, aux bonnes actions passées et aux prières, ressemble à la demande d’aide et dans les hadiths a été présenté de sources différentes de cette manière :
» ان الشمس تدنو يوم القيامه حتي يبلغ العرق نصف الاذن فبينما هم كذالك استغاثو بآدم ثم موسي ثم بمحمده(ص) «
« Certes, le soleil se rapprochera tant au Jour du jugement que la sueur parviendra jusqu’à mi-oreille. Tandis qu’ils seront ainsi, ils demanderont
le secours (istighathah) d’Adam puis de Moussa puis de Mohammad (as).
Cela montre qu’il n’y a pas de différence entre le recours (istichfa) et la demande d’aide (istighathah ). Le sens de la demande d’aide est que les prophètes (as) et les pieux ont auprès de Dieu, un statut spécial, et sont des moyens de parvenir à un vœu par la volonté de Dieu.
Comment l’être humain recourt-il à l’aide de Dieu ?
Dieu dit dans le Coran :
«يايها الذين آمنوا اتقواالله و ابتغوا اليه الوسيله.. »
Ô les croyants! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui!
Les meilleurs moyens sont la vertu et la crainte de Dieu, et le recours à Dieu, à ses noms sacrés, aux croyants vivants comme le faisaient les membres de la famille du prophète (as) et les compagnons, du temps de son vivant pour que vienne la pluie.
Mamousta Molla Ahmad Cheikhi, imam de la prière du vendredi de Salas-e Babajani, a déclaré que Hazrate Ali (as) au sermon 110 du Nahjol Balagha, avait utilisé cette méthode de recours, acceptable et reconnue par les sunnites
Mamousta Mollah Abdoullah Ghafouri, imam de la prière du vendredi de Ravansar, a déclaré que les actes pieux auxquels il est permis de recourir sont la prière, le respect des liens familiaux, le respect des parents, la compagnie des grands religieux et le respect des religieux décédés.
Akhund Rahim Bardi Samadi, imam de la prière du vendredi de Baghleq, a déclaré que les sunnites croyaient en l’intercession.
Molawi Tawakoli, imam de la prière du vendredi de Taybad, a déclaré qu’il était possible de recourir aux prières des justes et des religieux durant leur vie
Molawi Nourollah Farghani de Khalil Abad a déclaré que le recours était permis et que Hazrate Ali (as) dans le Nahjol Balagha, avait déclaré que le verset « «و بتغو ا اليه الوسيله concernait entre autre, le recours aux bonnes actions et la prière, et qu’il était possible de recourir aux prières du prophète (as) et des gens de bien.
Molawi Sharif-o-din Jami al Ahmadi, imam de la prière du vendredi de Torbat Jam, a déclaré que cette pratique ne posait pas de problème à condition de ne pas attribuer la réalisation de notre vœu à cette personne, mais à Dieu.
Molawi Amanollah, imam de la prière du vendredi de Sami’ Abad, a déclaré que Dieu dans le Coran, avait recommandé le recours à un « moyen » et que c’était le sens du mot « Tawasol », ajoutant que les religieux considèrent que ces moyens sont la prière, le jeûne ou les bonnes actions que nous avons faites, mais que la majorité pensent qu’il s’agit aussi de gens de bien vivants ou décédés, qui peuvent intervenir auprès de Dieu en raison du statut élevé dont ils jouissent auprès de Lui.
Qods restera à jamais arabe et islamique, insiste le chef du Hamas
Le chef du bureau politique du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas a souligné que la ville de Qods resterait à jamais arabe et islamique et aussi la première qibla des musulmans.

Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh l’a réitéré, lors d’une intervention, au cours de la cérémonie de « soutien à Qods », organisée, dimanche 17 décembre, en Turquie et diffusée en direct par vidéoconférence.
Haniyeh a dit que la décision arrogante de Trump sera annulée et qu’elle ne sera jamais appliquée en Palestine.
« Il n’existe pas un pays du nom d’Israël pour avoir une capitale. Nous défendons Qods et nous sacrifions pour elle nos vies et nos biens. La question de Qods ne concerne pas seulement la nation palestinienne, elle concerne toute l’oumma islamique », a martelé le chef du Hamas.